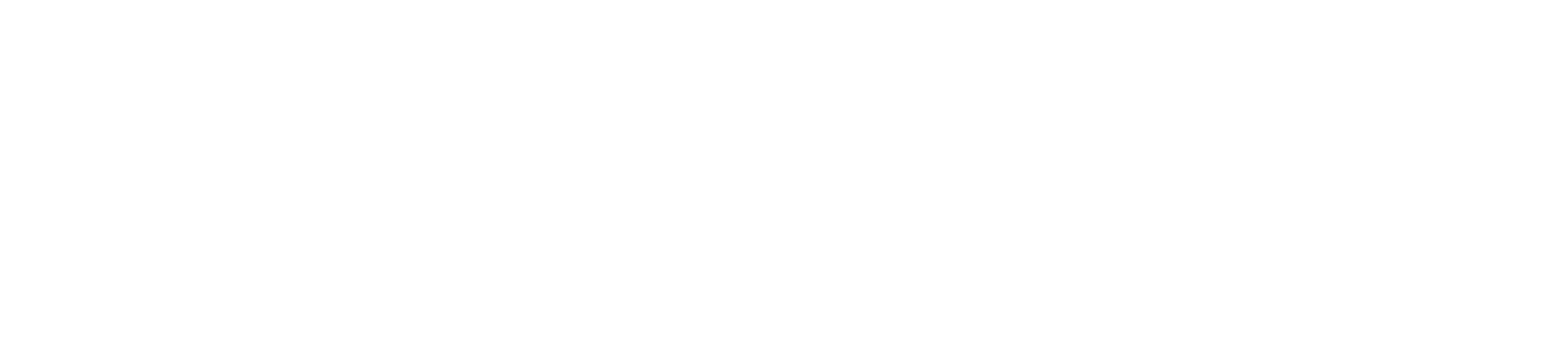Image : Portrait de Marie-Antoinette, anonyme, 18e siècle.
Source : The Metropolitan Museum of Art.
Là où le jardin français voulait démontrer la puissance humaine en domestiquant la nature, le jardin anglais privilégie la redécouverte de cette nature sous son aspect sauvage et poétique. Cette influence esthétique prend le pas dans le courant du XVIIIe siècle, dans une Angleterre en pleine pré-industrialisation. Ce jardin irrégulier devient une réaction assumée face à l’architecture pauvre des constructions liées au système économique en vigueur à cette époque. Le jardin anglais devient un symbole d’émancipation vis-à-vis de la monarchie absolue et de ses représentants. Le rejet de la symétrie et la remise en cause de l’idée de beauté dans la forme et la taille des jardins se fait miroir du refus de conserver des codes dépassés.
Cette nouvelle conception du jardin, portée en Angleterre par William Kent (architecte, paysagiste, peintre et graveur) et Lancelot « Capability » Brown (paysagiste), se répand dans toute l’Europe. En France, Marie-Antoinette suivra aussi cette tendance en faisant aménager un jardin à l’anglaise dans l’enceinte du Petit Trianon.
La conception irrégulière du jardin à l’anglaise symbolise le prolongement des paysages et est composée de chemins sinueux avec une végétation en apparence sauvage et non domestiquée. Les formes et couleurs des végétaux sont variées et les rochers, statues et bancs participent à la décoration du jardin. L’itinéraire n’est pas balisé et permet de se « perdre » en incitant à la rêverie et la flânerie. Une errance poétique propre à l’évolution de cette époque où le jardin devient peinture.